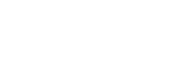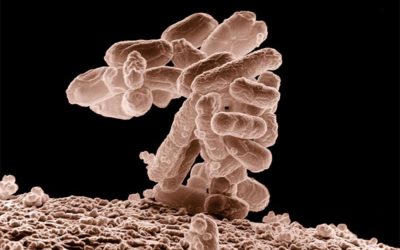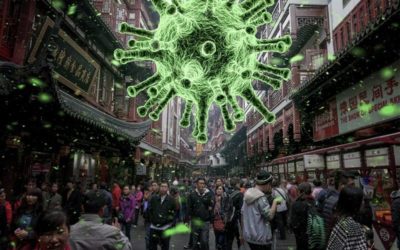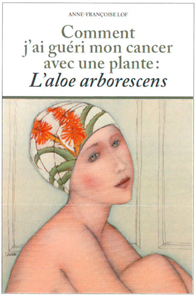Au-delà des affrontements qui mettent aux prises ceux qui se considèrent à plus ou moins juste titre comme les dépositaires du savoir officiel et ceux qui professent l’hérésie, se profile en fait un autre débat, de portée historique, susceptible de modifier irréversiblement le cours de la pensée médicale et d’induire une transformation en profondeur des concepts qui la sous-tendent.
Chaque étape est nécessaire à la progression de la science, comme est indispensable son dépassement. Interface entre le connu et l’ignoré, entre le logique et l’inexplicable, chaque palier cumule les incursions du savoir dans l’inconnu, les nouveaux acquis déduits de la logique du temps, au même titre que les intrusions de l’incompréhensible, les provocations de l’irrationnel. La rupture d’équilibre provient du constat de l’incapacité, pour la raison du temps, à appréhender des faits indicibles, ces fameux « faits » si « têtus ».
« Il y a plus dans le ciel et sur la terre que dans toute ta philosophie », disait Hamlet à son ami Horatio. C’est la philosophie qui change, et non plus le ciel et la terre.
Encore faut-il se livrer à une judicieuse analyse rétrospective, pour y ramener l’histoire réelle du courant dominant, dater ses premiers effets, et examiner à l’aide des nouveaux outils de la science ce qui aurait été autrefois éventuellement négligé, méconnu ou inconnu parce qu’insupportable ou incompréhensible et qui aurait été rejeté avec les scories des temps passés. Cette démarche, de fait rétrospective, est indispensable à la recombinaison qui précède et accompagne tout nouveau saut de connaissance. Il n’est qu’apparemment paradoxal que l’exploration du passé représente une condition d’accès au futur, car ce futur n’existe qu’il soit plongé dans le passé, de même que marche de cette progression vers la connaissance doit permettre de découvrir de nouvelles perspectives.
Il est du plus haut intérêt d’observer que d’une collectivité à l’autre, la médecine ne cesse d’évoluer sur les modes les plus variés, selon les normes de chaque civilisation, chaque culture, a donné au nécessaire rapport de l’homme avec la souffrance, la maladie, l’infirmité et la mort. Il s’agit là d’une sorte de validation du fait que c’est bien dans les contraintes d’un dialogue social que s’inscrit finalement le progrès de la connaissance médicale, comme c’est bien au travers d’un rituel collectif que le patient accède à la relation privilégiée avec le médecin.
Limites de la médecine dominante
Issue de sociétés pour qui le bien s’est identifié à l’avoir plus qu’à l’être, la médecine occidentale d’aujourd’hui a tendance à considérer, par sa conception actuelle, la maladie comme une perte ou un préjudice. Influencée par les exigences normatives des sociétés techniques, elle a participé à la définition, dans le champ de la santé, des critères sociaux de normalité et d’anormalité. Prodigieusement portée par les progrès des autres sciences et contribuant elle-même à l’exploration des dimensions mécaniques, chimiques, physiques et biologiques de l’être humain, elle a permis de faire progresser nos connaissances sur le fonctionnement et les dysfonctionnements de la machine humaine. Galvanisée par ses succès, emportée par son élan, la médecine occidentale s’interroge sur la suite à donner à tant de découvertes : la reproduction industrielle contrôlée de l’espèce, vers les technologies de simulation des divers organes vitaux, vers une meilleure maîtrise de l’humeur ?
S’éloignant de ce qui leur paraît être excessif et sous certains aspects abusif, un nombre croissant de médecins et de thérapeutes s’essaient à formuler différemment la problématique de leurs relations avec les malades et avec la maladie. Une majorité de patients d’aujourd’hui se prennent à rechercher ailleurs un dialogue, que la médecine de haute technicité sinon impossible avec les tenants de besoins prioritaires de communication. Un nouveau langage mal adapté se heurte à des exigences de fond et des difficultés du langage dominant à satisfaire ce besoin.
C’est dans un tel contexte que doit s’évaluer le véritable impact des médecines de terrain, leur signification et leur légitimité sociales. Il faut insister d’abord sur le fait qu’elles occupent une place rendue libre par le jeu de la crise de confiance. L’occupation de cette place signifie seulement qu’elles sont investies socialement d’un rôle dénié à d’autres ; elles n’en portent aucun mérite à priori. Ou, plus exactement, leur mérite initial est seulement d’être différentes et efficaces.
Autre rapport à la maladie
Une analyse attentive montre qu’elles sont créditées chacune par l’opinion, de plusieurs des qualités suivantes (dans des proportions fort variables de l’une à l’autre) :
- Elles sont douées dans l’ensemble d’une indiscutable efficacité.
- En refusant obstinément de le reconnaître, la médecine officielle se place dans une très mauvaise position vis-à-vis de l’opinion publique qui accorde le plus grand crédit à la convergence des témoignages favorables. De juge, la médecine officielle devient partie. Le plus souvent ignorante de tout ce qui caractérise ces pratiques, elle écarte d’un revers de main des avis identifiés sans grande valeur.
- Elles accordent une grande importance au dialogue et à l’écoute. À une époque où la médecine officielle inscrit son discours sur un faisceau de données scientifiques fort complexes, ces médecines-là adoptent un rôle porteur pour le patient, investissant sur son capital d’attention et restaurant sa place dans la gestion de son mal.
- Elles replacent l’événement pathologique dans l’histoire de vie du malade, partant d’une vision d’ensemble. Médecine holistique, médecine hippocratique, médecines énergétiques chinoises, médecines ostéopathiques, médecines homéopathiques et toutes les médecines naturelles, toutes considèrent le symptôme comme l’expression localisée d’un désordre plus large. En retour, le traitement vise autant à favoriser un rééquilibrage qu’un renforcement général qu’à réduire le trouble lui-même ressenti.
- Elles se font fort de n’user que des moyens thérapeutiques à faible risque pour le malade. Non exemptes de danger dans le geste, elles recourent à des procédés naturels non toxiques et ne se trouvent pas en compétition avec des pratiques médicales souvent coûteuses et dangereuses, les rendant de ceux qui les utilisent frappées de suspicion.
Ce sont là quelques-uns des arguments les plus généralement avancés pour justifier de l’indiscutable place qu’ont prise ces médecines dans l’opinion, y compris dans l’opinion médicale. La légitimité sociale ne relève pas du paradoxe puisqu’en définitive, peu importe à ce stade ce que ces appréciations soient soutenues par une institution savante, alors qu’il revient beaucoup plus important à la même institution de savoir si ces pratiques hétérodoxes bénéficient de faveurs justifiées ou non. Malheureusement, la médecine officielle de nos jours est en mesure jusqu’à maintenant d’entendre et rendre le message de celles dont les vertus sont partiellement reconnues. Cette « surdité » est lourde de sens si l’on se réfère à l’argumentaire développé plus haut, selon lequel la « babelisation » du discours dominant précède de la rupture épistémologique nécessaire à l’accès au savoir culturel. Sans doute le discours officiel d’aujourd’hui comporte-t-il quelques contradictions : « si les médecines douces ne sont pas des médecines de fonctionnaires », « si les médecines douces sont utiles pour les maladies bénignes », mais il faut malgré tout reconnaître que les médecines parallèles ont eu jusqu’à maintenant peu d’effets sur la médecine officielle, sinon de provoquer des prises de position plus ou moins heureuses.
La validité scientifique des médecines alternatives
En réponse à ceux qui s’inquiètent que l’opinion publique puisse ainsi donner sa confiance à des pratiques médicales qui n’ont pas reçu la sanction scientifique, il est facile de répondre que la double référence — savante et sociale — reste acceptable aussi longtemps qu’elle maintient sa cohérence et tend au même sens, mais qu’à l’instar du problème de la poule et de l’œuf, il faut bien qu’il existe un désaccord initial qui soit à la fois naissance soit à l’abandon. En cours de légitimation sociale, il faut que s’élabore la validation scientifique. Mais il existe à nouveau des obstacles épistémologiques redoutables à cette validation, car les mots n’ont pas le même sens dans les deux camps :
- Pour les tenants du discours dominant, validation signifie satisfaction aux critères existants et sur lesquels reposent leur propre validation et la reconnaissance du savoir actuellement établi.
- Pour les tenants d’un autre discours, validation signifie reconnaissance objective de leur originalité, de leur efficacité et de leur contribution à un élargissement du savoir. Pour eux, les critères officiellement en vigueur sont suspects de partialité et en général inadaptés.
Les tentatives récentes pour clarifier ces divergences d’interprétation ont bien montré que c’était là un problème de fond : la médecine officielle n’est pas actuellement en mesure de produire les outils et les procédures qui permettraient d’évaluer et de valider les pratiques médicales parallèles. Elle peut seulement édicter des exigences concernant les conditions générales à respecter dans l’intérêt des patients : non-toxicité relative des substances employées, strictes conditions d’hygiène dans les préparations de médicaments, formation du prescripteur et de l’exécutant à la prescription. Adaptés aux médicaments de composition chimique contrôlée, les procédures et les outils sont le plus souvent inapplicables à des thérapies qui ne relèvent pas de la pharmacothérapie la plus orthodoxe.
Pourquoi cette effervescence qui touche et les usagers et les praticiens ? S’agit-il d’une réaction de l’individu face à l’univers lourd et cloisonné de la médecine officielle ? D’une contestation “écologique” de médicaments trop “chimiques” ? Du refus de voir le corps réduit à ses seuls dysfonctionnements physiques et morcelé en de multiples spécialités ?
Si les médecines alternatives proposent un autre rapport à la maladie et d’autres modes de soins, leur séduction réside aussi, semble-t-il, dans ce qu’elles sont riches de représentations et de croyances sur l’être humain, le sens de l’existence, la place de l’homme dans l’Univers. Le strict cadre de la santé, de la maladie, de la médecine est, ici, largement dépassé.
Dès lors, entre la médecine scientifique qui voudrait retrouver une dimension plus humaine et les médecines différentes en quête, pour la plupart, d’une reconnaissance officielle, une évolution et des réaménagements sont de plus en plus probables.
Une approche innovante
La médecine holistique qui compte du terrain, comporte ces actions, elles sont :
- Réductionniste à l’extrême, elle ramène l’homme à un ensemble d’appareils et de fonctions indépendantes, et dénie la continuité et les interactions psychosomatiques comme fondements des mécanismes physiopathologiques.
- Élitis te, elle sélectionne parmi les situations et les malades celles et ceux qui sont susceptibles de valoriser son savoir et ses techniques. Elle n’hésite pas à se désintéresser de vastes groupes de patients tels les malades fonctionnels ou les personnes âgées, par exemple.
- Expérimentaliste, elle attribue une connotation négative à tout facteur ou événement qui nuit à la reproductibilité des phénomènes et à l’homogénéité des groupes étudiés. Cette attitude l’a conduite à manquer son rendez-vous avec la psychanalyse, qui posait en principe l’unicité, l’originalité de chaque être humain, la permanence des interactions et la rémanence du vécu. Cent ans n’ont pas suffi à combler le fossé, malgré les progrès et les contributions de l’immunologie au domaine si nouveau de la personnalité biologique et de ses désordres.
- Dualiste, elle procède par des séries d’oppositions qui figent d’emblée le système : la maladie par opposition à la santé, la cause du mal par opposition à celui qui en est atteint, le médicament par opposition à l’agent causal. Cette attitude rend impossibles des approches plus globales qui intégreraient tous ces éléments dans des concepts plus unitaires.
En définitive, la médecine occidentale moderne, dont la composante technique est très importante, doit sûrement une partie déterminante de son efficacité au champ d’action limité qu’elle s’est donné. En revanche, la complexité de son langage et la lourdeur de ses armes l’ont rendue progressivement inapte à la prise en charge d’une grande variété de situations pathologiques qui représentent aujourd’hui l’immense majorité des motifs de demande d’aide médicale et de soins.
Seule, la médecine générale, cette mal-aimée des facultés de médecine, a réellement cherché en France et en Europe à élaborer une réponse adaptée aux situations auxquelles elle est confrontée : le prix en a été une marginalisation académique massive et une minoration socio-économique de la valeur des actes accomplis. Il est aisé de comprendre, à la lueur de cet argumentaire, pourquoi tant de médecins généralistes se trouvent avec intérêt aujourd’hui vers toutes ces pratiques parallèles : conscients de la coupure qui s’établit entre le discours savant et le discours social sur la santé et la maladie, formés par l’écoute du discours social, ils sont à la recherche d’alternatives mieux comprises de la part de la collectivité : les médecines parallèles sont une réponse possible.
En témoignant qu’il peut exister d’autres manières d’appréhender l’homme dans sa maladie, ces dernières aident à comprendre que les temps sont proches, sinon déjà venus, où une nouvelle conception de la santé et de la maladie, et à travers elle une nouvelle médecine, devra impérieusement voir le jour pour permettre à toutes ces « médecines », entre temps apurées, de s’intégrer dans un ensemble cohérent : la science médicale aura alors franchi une nouvelle étape, atteint une nouvelle méthode d’où partiront les progrès futurs. Ainsi sera effacée la coupure épistémologique, à nouveau rétablie le continuum du discours médical à la fois dans l’histoire et dans l’instant, jusqu’à la découverte de nouvelles molécules innovantes de nouveaux traitements grâce à la médecine quantique te l’intelligence artificielle IA.
À quand la reconnaissance ?
Les nombreuses confrontations organisées par les pouvoirs publics ou par les médias n’ont pas réussi à vaincre toutes les réticences, tant s’en faut, mais elles ont eu pour effet de mettre en lumière de vastes zones d’ombre. À celles qui concernent les médecines alternatives et qui portent le plus souvent sur des concepts et un argumentaire qui se veulent rigoureux alors même qu’ils reposent sur des rationalisations approximatives, répondent les anomalies et les insuffisances de la technicisation technique dont le discours est actuellement dominant.
Pourquoi cette effervescence qui touche et les usagers et les praticiens ? S’agit-il d’une réaction de l’individu face à l’univers lourd et cloisonné de la médecine officielle ?
D’une contestation « écologique » de médicaments trop » chimiques » ? Du refus de voir le corps réduit à ses seuls dysfonctionnements physiques et morcelé en de multiples spécialités?
Si les médecines alternatives proposent un autre rapport à la maladie et d’autres modes de soins, leur séduction réside aussi, semble-t-il, dans ce qu’elles sont riches de représentations et de croyances sur l’être humain, le sens de l’existence, la place de l’homme dans l’Univers. Le strict cadre de la santé, de la maladie, de la médecine est, ici, largement dépassé.
Dès lors, entre la médecine scientifique qui voudrait retrouver une dimension plus humaine et les médecines différentes en quête, pour la plupart, d’une reconnaissance officielle, une évolution et des réaménagements sont de plus en plus probables.
A quand une nouvelle médecine intégrative qui ostracise les médecines parallèles.
*
* *
Dans « L’anti manuel de médecine » écrit par le docteur Jean-Paul Escande ancien chef du service à Cochin : « Il convient aujourd’hui, de mettre au centre des préoccupations les informations qui résument le patient. Vous n’êtes déjà plus des amoureux de la technique, qui recueillent et stockent les signes, les « données » traitées par l’informatique, et lisent la vision, grandis devant un ordinateur, accros à votre console de jeu, n’aurez de nouveau souci d’adhérer à ce monde virtuel. Pour vous, il est naturel : c’est votre monde ! Vous êtes des techniciens en formation.
Vous ne pourrez évidemment pas vous rendre compte, mais sachez qu’il s’est creusé un abîme entre les étudiants d’antan et vous-mêmes. Pendant leurs études médicales, vos prédécesseurs vivaient à l’hôpital auprès de médecins chevronnés comme autant d’apprentis essayant à dissiper les ténèbres de l’inexpérience et cherchant à acquérir un savoir-faire artisanal, pour exercer plus tard un métier de détective en solo. Vous exercerez, vous, d’emblée sous les vives lumières universelles de la Technique, dans un monde automatisé où règne l’exactitude. Le net n’est pas là pour vous rendre inventifs, astucieux, un peu « voyants », mais juste corrects, respectueux soumis à des normes et à des protocoles. La pratique médicale a cessé d’être un art. Elle est devenue un processus. Plus d’à-peu-près, mais de l’évaluable, du mesurable, du quantitatif.
Vous trancherez ainsi avec les médecins du passé, médecins dépassés qui ne parviennent pas à admettre le dogme de la civilisation informationnelle nouvellement énoncé par le philosophe Gilles Deleuze : « Aujourd’hui, on doit remplacer la nature par l’information. » De nos jours, cette observation a pourtant force de loi !
Les nostalgiques de l’ancien temps en sont encore à privilégier la nature humaine, les hommes et leurs rapports mystérieux, impalpables, naturels, en lieu et place des informations dématérialisées que l’on peut désormais en extraire. Ils appartiennent vraiment à une autre époque !
L’attachement des vieux médecins de plus de quarante ans à la médecine dépassée est cependant se comprendre. La vieille médecine humaniste ne manquait en effet ni de charme ni de chaleur. Ses héros étaient autant de figures attachantes et d’aventuriers : Louis Pasteur et Claude Bernard, Bichat et Laennec, Fleming et Barnard, etc.
Reconnaissons-leur certains mérites : les percées qu’ils ont réalisées, bien que tâtonnantes et approximatives, ont doté la pratique médicale d’une réelle efficacité. Et en raison même de cette efficacité, malgré le caractère aujourd’hui obsolète de la médecine d’avant les années 2000, les médecins formés à cette école sont tentés de lui rester fidèles. Après tout, l’automobile n’empêche pas le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle de rester plus vivant que jamais ! »
Pêle-mêle, et entre autres : à l’ère d’internet et de l’intelligence artificielle, a-t-on encore besoin des médecins ? La médecine « technicienne », est-elle humaniste. Parler du déficit de la Sécurité sociale a-t-il un sens ? Le complexe médico-industriel a-t-il une éthique ? Quel est le prix du malheur ? L’avocat est-il le nouvel associé du médecin ? y-a-t-il aujourd’hui de vraies innovations médicales ? peut-on décrypter les secrets du vivant ?
Les réponses aux problèmes posés passent par le champ de la politique : c’est donc maintenant ou jamais !
À quand le traitement du cancer, d’Alzheimer, de l’endométriose, de la Sclérose latérale amyotrophique, du papillomavirus, du Covid, des 55 maladies auto-immunes ? des maladies courantes non traitées par la médecine dominante… j’arrête la litanie
*
* *
UNE VOIE D’AVENIR : LA NUTRIPUNCTURE, UNE APPROCHE ADAPTATIVE DU TERRAIN INDIVIDUEL
Il s’agit d’une méthode originale, douce et efficace pour restaurer la vitalité cellulaire et soutenir l’homéostasie de l’organisme.
Mise au point par le Dr. Patrick Veret pendant 40 ans de recherches sur les lois naturelles de la communication cellulaire et les forces régénératives du vivant, la Nutripuncture contribue activement à la réintégration de la vitalité psychosomatique du patient.
DES RACINES MILLÉNAIRES
Fondée sur les connaissances millénaires de la tradition orientale, enrichie des récentes découvertes occidentales en biologie, physique et épigénétique, la Nutripuncture s’impose comme un outil précieux dans une approche intégrative de la santé et du bien-être, sans chimie ni effets secondaires, pour réharmoniser les fonctions altérés.
Elle ouvre la voie à :
- Une personnalisation des soins plus fine (bio-individualité)
- Une meilleure compréhension des réponses somato-psychiques
- Un axe de recherche prometteur sur l’influence de l’information cellulaire dans les phénomènes d’auto-régulation organique.
NOMBREUX CHAMPS D’APPLICATION
A partir des troubles du patient et de son terrain particulier, le praticien utilisera des séquences de complexes poly-minéraux personnalisées pour :
- Réactiver le potentiel vital des fonctions altérées
- Stimuler l’intégration cognitive des expériences de vie difficiles
- Drainer le terrain propice aux troubles fonctionnels et organiques.
Voici quelques exemples d’applications :
- Endométriose, troubles de la sphère génitale,
- Troubles digestifs,
- Apnée du sommeil,
- Fibromyalgie,
- Burn-out, dépression,
- Difficultés d’apprentissage, TSA,
- Troubles du comportement,
- DMLA,
- Troubles fonctionnels sans solutions concrètes.
Études cliniques et publications sur https://nutripuncture.fr/resultats-etudes-cliniques-nutripuncture/
Pourquoi se former ?
La Nutripuncture propose des formations certifiantes, réservées aux praticiens de tous horizons, pour intégrer dans leur spécialité une méthode d’investigation et des outils inédits permettant de :
- Protéger les fondements de la vitalité humaine
- Renforcer l’intelligence cellulaire
- Apporter un soulagement immédiat dès la première consultation, guider la personne vers un état de bien-être global
- Observer le trouble dans sa dimension psychosomatique
- Identifier l’information à l’origine du dysfonctionnement.
- Découvrir les relations complexes entre l’individu et son environnement, entre son corps et sa psyché.
Contact
Par mail : formation@nutripuncture.fr
Par téléphone : 07 65 16 44 12
Plus d’informations sur la méthode, ses champs d’application et les études sur le site officiel :