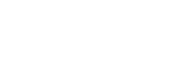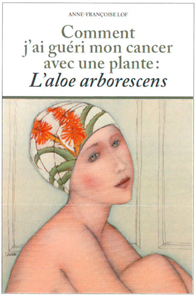La bipolarité chamboule les humeurs, entre vertiges et abîmes, et fait de l’existence un parcours d’obstacles.
La bipolarité est un trouble complexe. Cette maladie qui touche 5% de la population est envahissante, terriblement invalidante, dont les ravages sont personnels, professionnels, physiques, psychologiques, relationnels, sexuels, financiers. Une maladie classée sixième fléau planétaire, selon l’OMS, qui estime qu’un adulte sur quinze risque de traverser, au moins une fois dans sa vie, un épisode maniaque ou dépressif.
Autrefois, ce mal étrange s’appelait maniaco-dépression, puis, le diagnostic s’affinant, les spécialistes lui ont donné cette appellation, hermétique pour le profane, de bipolaire, car le malade navigue entre deux pôles, l’un constitué de phases d’intense exaltation dites maniaques, l’autre fait de phases de dépression sévère. Le mot manie et son adjectif maniaque signifient pour les psychiatres tout autre chose que dans le langage commun. Si la manie se dit couramment de l’obsession qu’a une personne de bien ranger ou de bien nettoyer, un maniaque est, pour les psys, une personne traversant un «épisode de tous les ex, excès, ex-citation, exaltation, exubérance». La vie bipolaire fluctue entre des hauts et des bas, elle balance de la surexcitation sensorielle jusqu’au dégoût de tout, elle navigue entre l’envie de croquer le monde puis l’atonie suicidaire. Une vie de vertiges et d’abimes, comme si les humeurs étaient définitivement embarquées dans la nacelle d’un grand huit de foire. Le malade traverse cette alternance épuisante plusieurs fois dans l’année, ou plusieurs fois au cours de sa vie, ou encore plusieurs fois dans le mois.
Enfin, ajoutons que l’adjectif bipolaire s’entend aussi par opposition avec la dépression dite unipolaire, celle qui ne présente d’aucune phase maniaque et qui ne sera qu’un gouffre morose et léthargique.
Combien de bipolaires en France ? Les chiffres fluctuent entre 4 et 6,4 % de la population adulte. Ils augmentent à tel point que certains médecins s’alarment d’un surdiagnostic du trouble, constatant que, outre l’explosion du nombre de malades, le catalogue des symptômes s’élargit. Les spécialistes s’indignent de ce reproche, ils expliquent que cette maladie malcommode à reconnaître, d’une part, serait de mieux en mieux dépistée et que, d’autre part, notre époque la favoriserait, notamment chez les jeunes. « Nous vivons dans un monde de surstimulation constante, observe ainsi le psychiatre Elie Hantouche. L’excitation des écrans, des téléphones, le raccourcissement des cycles de sommeil, la viande rouge et la junk-food, l’obligation d’être constamment connecté, réactif, vigilant altèrent les temps nécessaires de repos et de calme. On rajeunit la maladie, on l’excite. Alors, oui, les chiffres sont constamment revus à la hausse.»
Fluctuations des humeurs
La bipolarité est une maladie fascinante, car elle intensifie toute la gamme des humeurs humaines, elle accentue l’incroyable palette émotionnelle dont nous disposons et repousse loin les limites de l’organisme. Le bipolaire en phase maniaque peut, se passer de dormir, de manger et accomplir néanmoins des prouesses physiques et mentales.
« Dans la manie, la personne ne connaît plus ni freins ni censure. Elle est désinhibée, insomniaque, hypersexualisée, elle dépense à tout-va, conduit à vive allure. Soudain, les odeurs, les couleurs, les goûts sont amplifiés », remarque encore Elie Hantouche. Si le trouble bipolaire « se caractérise par des fluctuations d’humeur spectaculaires ou inhabituelles», il se divise en deux groupes : le trouble bipolaire I, soit une phase maniaque associée à des épisodes dépressifs, qui touche à égalité les hommes et les femmes, et le trouble bipolaire II, dont 80 % des sujets sont des femmes, soit une dépression associée à une phase dite hypomaniaque, soit une forme légère de crise maniaque. Les bipolaires I- représente 1 % de la population française adulte – ils se reconnaissent assez aisément, tant la phase maniaque est délirante.
Identifié par les policiers
Les meilleurs connaisseurs du trouble sont sans conteste les policiers qui arrêtent ces malades à moitié nus, ivres, hurlant dans la rue, pour les conduire de force en hôpital psychiatrique… Les bipolaires II sont, quant à eux, malaisés à diagnostiquer, car l’hypomanie est souvent bien vécue par les patients. Tout au moins pendant un temps. Energie dense, capacité de travail décuplée, humeur exubérante : l’hypomaniaque peut certes fatiguer son entourage, mais qu’importe, puisqu’il obtient des résultats professionnels formidables, enchante ses proches de saillies verbales fulgurantes, élabore des programmes dignes d’un narcissique. Il se sent si fort qu’il lui est difficile de croire qu’il a dans cette enivrante puissance franchi les limites d’une régulation normale de l’humeur et que la fin de cet épisode se soldera par une plongée brutale. « Un puissant élan ou stimulus intérieur les pousse à travailler plus dur, à être encore plus productifs et à réussir encore mieux, détaille le docteur Fieve. Les hypomaniaques n’ont aucun mal à idéaliser leur humeur jusqu’à ce qu’ils fassent l’expérience du jeu compulsif, de la ruine, de l’abus de substances.» Ils consultent lorsque la phase s’achève pour laisser place au terrible effondrement de la dépression.
La cassure
«Le premier signal d’alerte est celui de la cassure. La personne a le sentiment d’avoir perdu son identité, d’être devenue une autre, que ce soit dans la phase haute ou dans la phase basse». Certes, mais si chacun de nous traverse des journées euphoriques et s’en trimballe d’autres bien mornes, quand doit-on considérer que cet arc-en-ciel d’émotions, consubstantiel à la nature humaine, est pathogène ? Le pathologique, est atteint quand les symptômes s’intensifient, se multiplient et s’installent durablement. La tristesse et la joie appartiennent à l’existence; seulement, lorsque la tristesse est associée à la dévalorisation de soi, au désintérêt général et à la perte de sommeil, ou au contraire à la fatigue constante, dès lors il faut consulter Idem quand l’énergie, l’euphorie et la stimulation deviennent des compagnons de chaque instant, privant le sujet de repos et de fatigue; il convient alors également de s’interroger. Consulter c’est une démarche à laquelle le patient se soumet moins volontiers.
Différentes formes de bipolarité
Type 1 : Correspond aux anciens « maniaco-dépressifs». Leur humeur fluctue entre des phases maniaques caractérisées, très aiguës, et des phases de dépression profonde. C’est la forme la plus «bruyante» et la plus fréquente de cette maladie.
Type 2 : Plus discret. Les phases d’excitation sont modérées (les spécialistes parlent d’hypomanie) et n’empêchent en général pas la vie en société. Les épisodes dépressifs passent au premier plan et sont parfois très importants.
Type 3 : Regroupe des patients assez similaires à ceux du groupe 2 mais chez qui le traitement antidépresseur provoque des hypomanies.
La classification est complexe, car il existe des sous-catégories de ces types et de multiples autres formes. On parle même de «millefeuille qui évolue en permanence».
Le point de départ
Les causes sont variées, les troubles bipolaires ne surviennent que si trois facteurs de risque sont réunis : une vulnérabilité génétique, une hypersensibilité et la survenue d’événements graves.
Le premier élément est la susceptibilité génétique. La maladie n’est pas portée par un gène transmissible, mais son apparition est favorisée par la présence d’un certain nombre de gènes. Certains jouent un rôle important dans nos rythmes biologiques, dans notre horloge interne. Conséquence: les enfants de parents atteints présentent un risque multiplié par cinq à dix de développer la maladie. Le risque est même multiplié par trente si les deux parents en sont atteints. Le deuxième élément caractérisant ces malades est une hypersensibilité. Rien, pour eux, n’est neutre.
Enfin, l’environnement affectif joue un rôle. Chez les personnes qui présentent un terrain à risque, les deuils, la perte d’un emploi ou un divorce peuvent avoir des conséquences fâcheuses. De nombreux travaux montrent que l’épisode maniaque survient, dans 30 % des cas, au cours du mois qui suit l’événement déclencheur.
La moitié des patients bipolaires présentent une addiction, le plus souvent à l’alcool ou au cannabis.
Les bipolaires souffrent deux à trois fois plus de maladies cardio-vasculaires.
Leur espérance de vie est réduite en moyenne de dix ans.
15 à 20% des patients non traités se livrent à des tentatives de suicide.
Le dérèglement des humeurs
Tout est biochimie dans notre vie. L’humeur et les émotions n’échappent pas à la règle. C’est grâce à des messagers particuliers fabriqués par l’organisme, les neurotransmetteurs, que les cellules nerveuses communiquent entre elles et que le corps «obéit». Concernant l’humeur, la dopamine joue le rôle de starter. L’adrénaline fournit l’énergie et la sérotonine la sérénité, toutes deux nécessaires pour mener les projets à bien. L’humeur normale est faite de hauts et de bas, en fonction des moments, des émotions et de la sécrétion de ces neurotransmetteurs. C’est ainsi que les fluctuations importantes, persistant longtemps et ayant des conséquences négatives sur la vie quotidienne, signent cette maladie
Comment dépister ces troubles ?
C’est facile pour les formes les plus «bruyantes» – un coup de folie, une atteinte à la pudeur, une bagarre, un vol -, du fait que les malades finissent le plus souvent à l’hôpital. C’est bien plus problématique dans les autres cas. Il faut d’ailleurs en moyenne huit ans et la consultation de quatre ou cinq médecins différents avant d’arriver au bon diagnostic. Mais, à la décharge des médecins, lors des phases d’hypomanie, les bipolaires de type Il se sentent intelligents, réactifs, performants, drôles… Il est rare, alors, qu’ils consultent.
Un diagnostic délicat
Bipolaire, un diagnostic à la mode qui pullule sur Internet ou sert d’invective commode entre amis fatigués par la déprime passagère d’un des leurs. Le trouble bipolaire serait devenu un vaste groupe fourre-tout de troubles très divers, allant du coup de blues persistant jusqu’à des formes graves de la maladie. Méfions-nous du surdiagnostic de ce mal hétérogène. Or le paradoxe est que, si certains sont hâtivement et à tort catalogués bipolaires par des médecins peu formés, d’autres, souffrant réellement de cette maladie, vivent un véritable parcours du combattant avant d’être pris en charge. Les généralistes peinent à reconnaître cette maladie, dont les formes d’expression sont diverses. La solution pour établir un diagnostic sûr serait de consulter dans un centre expert. Il est important de ne pas porter un diagnostic trop rapide, car les effets secondaires des traitements sont prédominants lorsqu’ils sont prescrits sans indication adaptée. De même que diagnostiquer une dépression et donner un antidépresseur à un bipolaire peut augmenter les phases d’exaltation et les risques de suicide. Les généralistes ne sont pas assez formés, mais les psychiatres non plus. Pourtant, les différentes variantes du trouble bipolaire ne doivent pas être traitées de la même manière. Si les nouveaux traitements comme les régulateurs d’humeur ou thymorégulateurs seraient efficaces pour les formes graves, les traitements prescrits pour des formes plus légères exigent une expertise très fine, dont ne disposent pas toujours les médecins. Or un patient diagnostiqué à tort n’osera pas arrêter son traitement.
Par facilité, le médecin continue à le prescrire alors qu’une psychothérapie suffit parfois. « Il ne faut pas hésiter à prendre plusieurs avis, conseille le psychiatre. Mais en aucun cas un traitement en cours ne doit être arrêté brutalement ! »
Cerveau particulier des bipolaires
Les examens du cerveau des bipolaires sont extrêmement sensibles aux émotions, y compris en dehors des périodes de crise. Une expérience très significative consiste à présenter à des sujets contrôles des images à tonalité positive (photos érotiques), neutre (un objet) ou négative (un accident) et à enregistrer l’activité de leur amygdale cérébrale sous IRM. Ils ont des réactions disproportionnées, ce que confirment d’ailleurs des enregistrements électrophysiologiques (comme la mesure de la transpiration à la surface de la peau, utilisée dans les détecteurs de mensonge). Chez eux, le neutre (marqué par aucun sentiment) n’existe pas.
L’IRM fonctionnelle montre une activité très importante de l’amygdale cérébrale, cet organe qui génère les émotions, et, parallèlement, un moins bon contrôle du système préfrontal, normalement chargé de réguler la réponse émotionnelle. Ce phénomène est encore plus marqué pendant les phases maniaques.
Par ailleurs, le cerveau d’un individu sain en manque de sommeil ressemble beaucoup à celui d’un bipolaire. L’activité de l’amygdale est décuplée.
Les résultats observés indiquent que le sommeil, et surtout le sommeil paradoxal, régule en atténuant l’activité émotionnelle le siège de l’émotion et de la peur est dans l’amygdale).
On comprend donc mieux les effets néfastes de la privation de sommeil ou des nuits de mauvaise qualité chez les malades bipolaires dont l’amygdale est déjà suractivée.
L’épisode maniaque dure au moins une semaine ; il revient de manière régulière, soit tous les trois mois, soit une fois par mois, soit une fois tous les cinq ans. L’apparition d’un seul épisode maniaque suffit à diagnostiquer la venue d’une maladie bipolaire.
Les médicaments classiques de l’humeur
Ils appartiennent à trois familles :
Le lithium, les antiépileptiques et les antipsychotiques atypiques, nom donné aux neuroleptiques modernes, qui ont moins d’effets indésirables que les plus anciens. Ces traitements entraînent très souvent une prise de poids, parfois des tremblements et une sécheresse de la bouche, plus rarement un diabète, des troubles de la thyroïde, des complications hépatiques, d’où la nécessité d’une surveillance. Leurs effets sont parfois très longs à recenser.
Le lithium, un métal magique !
Un point important, car les doses thérapeutiques sont voisines des doses toxiques. A partir de là, le lithium est prescrit dans le monde entier. C’est devenu le premier médicament psychotrope qui modifierait la vie des bipolaires.
Par ailleurs, le lithium induit une prise de poids et a des effets néfastes à long terme sur les reins et sur la thyroïde. « C’est ainsi qu’il fut mis entre parenthèses»,
Des recherches sont menées pour découvrir une molécule aussi efficace et mieux tolérée. En vain, d’où le retour de la prise du lithium, mais sous surveillance très stricte. Depuis, les travaux concernant le mécanisme d’action du lithium se multiplient. On sait maintenant qu’il intervient, notamment, sur notre horloge interne et sur la sécrétion de mélatonine. Le lithium réactive certains gènes qui sont dérégulés dans les troubles bipolaires. De plus, c’est le seul médicament qui ait une efficacité démontrée sur la prévention des suicides. Un plaidoyer d’autant plus important que cet élément naturel – et bon marché – n’intéresse pas l’industrie pharmaceutique. L’impossibilité de faire des profits avec ce traitement pourtant indispensable serait, pour certains, l’une des hypothèses avancées pour expliquer les tentatives de marginalisation du lithium.
Les accès dépressifs bénéficient des médicaments antidépresseurs et des électrochocs (sismothérapie). Les accès maniaques sont calmés par les neuroleptiques. Une hospitalisation sous contrainte (HDT = hospitalisation sur demande d’un tiers) est souvent nécessaire, associée parfois à une protection des biens en cas d’accès maniaque (risque de dépenses considérées).
PRÉVENTION
Le risque de récidive justifie un traitement préventif lors du retour à l’état normal (sels de lithium [par ex. Théralithe®], carbamazépine [Tégrétol®]) et une prise en charge psycho-thérapeutique.
Des génies bipolaires
Ernest Hemingway
L’écrivain américain, prix Nobel de littérature, fut interné à sa demande à deux reprises à la clinique Mayo dans le Minnesota pour y soigner sa bipolarité. On lui administra des électrochocs et de puissants sédatifs, sans grand effet curatif. Il se suicida, comme le firent son père, son frère et sa sœur.
Vincent Van Gogh
D’après une équipe d’universitaires de Lausanne (Suisse), le peintre néerlandais alterna entre des phases hypomaniaques, des épisodes psychotiques, des hallucinations et des pertes de contact avec la réalité.
Un trouble bipolaire qui le mena au suicide, inspiré par ses audaces picturales.
Charles Dickens
Ce grand romancier britannique serait aujourd’hui diagnostiqué bipolaire. L’auteur d’« Oliver Twist» était déséquilibré, il trouvait un grand réconfort dans ses personnages, dont il parlait comme s’ils étaient réels. Il ne se serait jamais remis de l’emprisonnement de son père.
Napoléon
D’humeur souvent exaltée, le génie militaire manifestait deux symptômes d’un trouble persistant de l’humeur : une alternance de maigreur et d’embonpoint comme l’absence de fatigue. Capable de longues privations de sommeil, l’empereur passait des heures à cheval sans éprouver le besoin de se reposer.
Isaac Newton
Le physicien, mathématicien et astronome anglais ne se remit jamais de deux traumatismes : le décès de sa mère et la destruction accidentelle de son laboratoire. En proie à une profonde dépression, qui l’enferma trois ans, il demeura en proie à de fortes variations de l’humeur et fut victime de crises paranoïaques.
L’acteur Benoit Poelvoorde
«Je ne suis pas malade. Je suis bipolaire. J’ai des hauts et des bas, je suis lunatique, soumis à des états psychiques variables.» C’est ainsi que l’acteur belge Benoit Poelvoorde parle de lui en 2010.
Trois ans plus tard, l’autodiagnostic change: «Je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas maniacodépressif, je ne suis pas sous lithium. J’ai des hauts et des bas, comme tout le monde.»
Traitement naturel
Vous trouverez une thérapie alternative de cette maladie bien complexe dans mon livre (page 390) : « 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes ». Ed. Trédaniel.
En homéopathie selon 3 états :
- Pôle dépressif
- Pôle maniaque
- Atteinte bipolaire
+ Les plantes
+ Gemmothérapie
+ Huiles essentielles
+ Oligo-éléments
LES HUILES ESSENTIELLES QUI PROTÈGENT LE SYSTÈME NERVEUX
L’exposition à des polluants environnementaux neurotoxiques (les pesticides, les métaux, ou d’autres produits chimiques) est reconnue comme un facteur de risque « clé » dans l’apparition de maladies neurodégénératives.
Les formes de « neurotoxicité» le plus souvent rencontrées sont :
- La mort des neurones, appelée « neuropathie ».
- La dégénérescence des axones, appelée « axonopathie ».
- Les lésions des cellules gliales (par exemple « myélinopathie »).
- L’interférence avec la membrane axonale ou la « neurotransmission ».
Beaucoup d’huiles essentielles sont fort intéressantes, afin de lutter contre une neurotoxicité provoquée par différents polluants environnementaux, tels que le glyphosate, l’aluminium, le zinc, le Tamoxifène, ou autres. Toutefois, seules certaines d’entre elles ont été sélectionnées, car elles ont fait l’objet d’études scientifiques « rigoureuses », auprès de la communauté scientifique internationale. Ci-dessous la liste de ces différentes huiles essentielles (non exhaustives) :
HE Acore odorant
HE Anis vert
HE Cannelle vraie
HE Chanvre cultivé
HE Citronnelle de Java
HE Eucalyptus globulus ou Gommier bleu
HE Fenouil doux (Foeniculum vulgare)
HE Garcinia (Garcinia atroviridis)
HE Géranium odorant
HE Gingembre officinal
HE Girofle
HE Lavande fine ou vraie
HE Lemongrass des Indes
HE Marjolaine à coquilles
HE Myrrhe
HE Néroli
HE Osmanthe fragrante
HE Palmarosa
HE Romarin officinal
HE Rose de Damas
HE Sauge arbustive ou de Grèce
HE Sauge d’Espagne
HE Verveine odorante ou citronnée
Ess. Citron
Ess Mandarine rouge
Ess Bergamote
Le système endocannabinoïde
Le système cannabinoïde endogène, c’est-à-dire endocannabinoïde, intervient dans de nombreux processus physiologiques normaux ou pathologiques, par la régulation homéostasique des fonctions cérébrales.
Au niveau des processus physiologiques, il contribue à améliorer l’efficacité des synapses (synaptique), les fonctions cognitives, la neurogenèse, la diminution de la sensation de douleur, le stress et la régulation de l’appétit.
Au niveau des processus pathologiques, c’est-à-dire un dysfonctionnement cérébral et les maladies nerveuses: il lutte contre une neuro-inflammation, une neurodégénérescence, l’épilepsie, un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale traumatique.
Le chanvre contient plus de 100 cannabinoïdes dont le CBD. Ce CBD fait l’objet de nombreuses études scientifiques depuis quelques années tant son potentiel thérapeutique apparaît immense au regard du peu d’effets indésirables qui le concernent.
Le chanvre est une plante adaptogène pouvant jouer sur le système endocannabinoïde impliqué dans la régulation du développement neurologique, de la mémoire, du sommeil, de la douleur, de l’inflammation ou encore de la fonction immunitaire.
Par ailleurs, le CBD agit comme une molécule multicible grâce à ses effets modulateurs sur différents niveaux cellulaires, tissulaires et organiques, principalement par l’intermédiaire des récepteurs CB1 et CB2.
Huile au CBD
Cette huile de coco bio est enrichie en CBD (15%) extrait de Cannabis sativa. La traçabilité totale de l’isolat de CBD permet de garantir les taux de CBD annoncés, l’absence de THC (molécule responsable de l’effet psychotrope du chanvre) et sa parfaite sécurité d’emploi aux doses conseillées.
À la différence de l’huile de chanvre, l’huile de coco est peu sensible à l’oxydation, ce qui assure la stabilité de notre produit vis-à-vis du rancissement.
La prise sublinguale permet d’améliorer l’assimilation du CBD.
Le cannabidiol n’est pas une substance illicite ni récréative car elle n’a pas d’effet psychotrope. La dose de CBD doit être personnalisée car ses effets pour un même dosage varient d’un individu à l’autre, selon leur sensibilité.
Bin agiter avant emploi.
2 fois 5 gouttes sous la langue.
Déconseillé aux femmes enceintes et enfants
Labo Le Stum – Tel : 02 57 88 15 88
*
* *
Masterclass le 15 décembre « Troubles de la thyroïde ».
J’aurai le plaisir de vous retrouver pour une Masterclass en live, concernant les troubles de la thyroïde, avec Orthomolecular Academy, le mardi 15 décembre 2025 à 19h30 (Heure de Paris).
Horaires : De 19h30 à 21h30 / Format : En ligne, sur Zoom
Un replay sera mis à disposition après l’évènement, pour tous les participants inscrits, même si vous ne pouvez pas participer au direct.
Informations & inscriptions sur : Masterclass exclusive avec le Dr Jean-Pierre Willem – Troubles de la thyroïde – Orthomolecular Academy