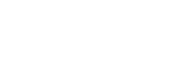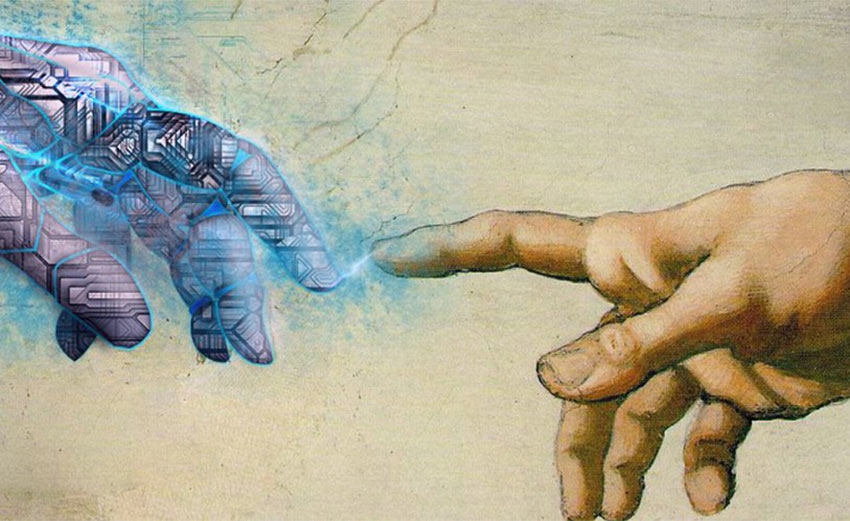À l’époque où j’ai décidé de faire médecine, on évoquait le sacerdoce, autrement dit une fonction sacrée. Il en était de même pour les prêtres. Par ailleurs nous sommes les seuls à parler de confrères. Le prêtre (foi) et le médecin (science) ont des points communs. D’où ce texte sur le thème science et foi.
Il peut paraître prétentieux de traiter d’un tel sujet lorsqu’on n’est ni philosophe, ni théologien.
J’invoquerai, pour me justifier, que comme médecin et anthropologue spécialisé dans la spiritualité, j’ai dû acquérir une certaine formation en philosophie ; mais surtout je suis personnellement engagé sur le double chemin d’un métier scientifique et d’une croyance catholique. Partagé, et parfois même écartelé entre ces deux appartenances, j’en cherche l’éventuelle synthèse, si synthèse il y a… D’où les réflexions qui suivent, et qu’il faut percevoir plus comme un appel à la critique et aux suggestions nouvelles que comme des affirmations tranchées. Que les spécialistes veuillent bien pardonner les maladresses probables de ce texte : leurs doctrines n’ont peut-être pas toujours passé la rampe jusqu’au profane de la base que je suis.
Pour les catholiques, il n’y a pas de conflits insolubles entre la science et la foi.
Bien sûr, nous savons que l’Eglise témoigne d’une longue histoire de résistances diverses aux affirmations de la science. Galilée en constitue le paradigme trop souvent rappelé. La critique historique scientifique des textes sacrés en est un autre exemple. Plus près de nous, nous avons connu la quasi-condamnation de l’évolutionnisme par Pie XII ; plus récemment encore, la méfiance durable de l’Église envers la psychanalyse ; sans oublier la condamnation répétée des méthodes contraceptives au nom d’une notion de la nature humaine antinomique de celle que propose la science, etc.
Comme scientifiques et comme médecins, nous sommes habitués à régler dans nos vies ces problèmes et les malaises qu’ils engendrent. D’une part, nous critiquons l’obscurantisme des gens d’Église, les taxant d’ignorance. Avec le temps, l’instruction leur vient, et dès lors ils trouvent des solutions heureuses. Ils ont accepté que la terre tourne autour du soleil, ainsi que la critique historique, en comprenant que les textes bibliques ont une valeur symbolique et non pas littéralement historique dans chaque détail. D’autre part, nous pensons que la science finira par trouver des méthodes contraceptives plus satisfaisantes techniquement, et conformes du même coup aux théories religieuses. De même pour la psychanalyse, et ainsi de suite.
Nous renvoyons ainsi les extrémistes dos à dos. Si quelques théologiens s’accrochent à des affirmations trop tranchées, nous en lisons d’autres, plus souples ou modérées. Et si Poincaré ou Monod prêchent un rationalisme strict, nous les considérons comme des scientifiques qui s’avancent abusivement sur le terrain philosophique et s’y brûlent les ailes. Nos philosophes et nos théologiens ne nous l’affirment-ils pas, même s’ils sont un peu compliqués à comprendre ?
C’est d’ailleurs compliqué à comprendre. Il faut donc être un spécialiste pour en discuter. Nous faisons confiance à nos spécialistes : science et foi sont compatibles puisqu’ils nous l’affirment ! Nous voilà donc rassurés. Le petit malaise que cette polémique pouvait avoir suscité s’apaise en nous. Nous gardons fermement à l’esprit quelques phrases clés solidement affirmées. Et nous vivons tranquilles désormais. Mais je pratique un métier dans lequel on pense que tout malaise, même lorsqu’il parle bas, peut cacher un problème important. Nous pouvons penser que science et foi sont largement compatibles, et que les divergences présentées ne sont que locales et temporaires. Elles n’en sont pas moins persistantes au présent. Je peux donc me demander si ces divergences n’en recouvrent pas d’autres, plus profondes. À vouloir les apaiser trop vite, ne risquons-nous pas de perdre toute une critique positive de la science comme de la foi ? Avec des conséquences concrètes, peut-être, dans notre façon de nous traiter nous-mêmes, les autres, les malades et même les athées ?
Quand j’entends un médecin catholique pratiquant et convaincu me dire que tout ce qui concerne l’amour n’est finalement qu’une question d’hormones, je m’interroge sur notre formation. Mais aussi quand un collègue athée se déclare stupéfait de l’étendue du rationalisme positiviste des médecins catholiques qu’il rencontre. Ou lorsqu’un collègue m’aborde pour me dire qu’il vient de découvrir que psychanalyse et religion ne sont peut-être pas antinomiques.
In fine, le malaise d’une incompatibilité possible entre science et foi demeure.
J’ai utilisé le mot : malaise. Ce terme doit être pris au sérieux. Ne témoigne-t-il pas du désir que science et foi s’accordent ? Quel est l’enjeu de ce désir ? Autrement dit, à quoi nous servent et la science et la foi, qui soit tel que leur désaccord nous en priverait ? Posant ainsi la question, je voudrais remplacer le terme de foi par celui de religion ou de savoir. Dans notre vie concrète et historique, c’est généralement la religion qui nous sert d’introduction à la foi, à tel point qu’elle est fréquemment confondue avec celle-ci. Voyons donc science et religion d’abord. Religion, comme l’ensemble de propositions ou dogmes, ensemble de règles morales ou éthiques, ensemble de rites ou liturgie et, enfin, comme institution organisée.
Notre question devient donc : à quoi voulons-nous faire servir science et religion, qui les exige compatibles ?
Une première réponse m’apparaît assez évidente : de la science comme de la religion, nous attendons une maîtrise sur le bien-être, voire sur le bonheur de nos existences. Et il semble que l’une et l’autre prétendent répondre à cette demande.
Cette proposition est, somme toute, assez simple et ne nous parait guère pouvoir encourir de refus. Or cette attente de bien-être ne rassemble pas la science et la religion, mais au contraire les oppose le plus souvent dans des démarches antagonistes dont témoigne toute l’histoire des trois derniers siècles. Auparavant, il était normal de prier pour la pluie, la sécheresse, la foudre, la maladie, la naissance, les tremblements de terre, le mariage, la mort, etc. La visée d’efficacité de ces prières avait pour démarche de séduire Dieu, en quelque sorte, afin d’en obtenir les biens que sa puissance lui permettait de nous dispenser.
De plus en plus souvent, nous requérons maintenant cette puissance de la science. Il est un peu risible de prier pour qu’il pleuve, de nos jours. Mais il n’est pas risible d’irriguer, ou d’arroser les nuages d’iodure d’argent.
Tout ce que la science a gagné en efficacité, Dieu et la religion l’ont perdu. Du même coup, Dieu est petit à petit chassé de nos existences comme acteur quotidien de nos destinées. Les Rogations quittent la liturgie de même que disparaissent beaucoup d’anciennes oraisons.
Le peuple, de même, quitte nos églises : combles sous les menaces de guerre, elles ont été vidées par l’accroissement du confort technique des dernières années. L’Église et la religion ont vu s’effondrer des pans entiers de leur influence quotidienne dans nos vies. En matière de quête du bien-être, la science chasse donc la religion et met la foi des gens en péril, indiscutablement.
Du même coup évolue peu à peu le type d’efficacité recherché. Si elle réussit assez mal à tenir sa promesse de bien-être matériel, la religion se réfugie volontiers dans le bien-être psychique et social. Il n’est pas rare, à l’heure actuelle, qu’elle prône comme œuvre de charité la justice sociale, la solidarité, l’accompagnement des malheureux de ce monde, en faisant de ces attitudes une promesse de bonheur dans la vie terrestre. Dans son aspect moderne, et pour répondre à notre demande de bien-être, la religion se déplace ainsi vers le terrain socio-politique.
Il serait cependant erroné de croire que la science ne lui conteste pas ce terrain. Sans doute y a-t-elle mal réussi jusqu’ici à travers le socialisme « scientifique » et le capitalisme technocratique. Mais les scientifiques sociologues, politologues et économistes ne considèrent nullement ces échecs comme définitifs. C’est bien la société harmonieuse, le bien-être partagé par tous que la science vise. La religion risque bien, dès lors, de perdre aussi ce terrain-là, tôt ou tard.
Restent l’échec individuel et la mort. Là se trouvent les refuges les plus assurés de la religion, depuis toujours. L’échec et le malheur entraînent généralement le mépris des autres. La religion nous garantit la sollicitude infinie de Dieu. Elle nous assure même, dans une certaine mesure, le soutien de ceux qui, se réclamant de Dieu, ne nous mépriseront peut-être pas. Au lieu de considérer la mort comme un terme, elle nous propose l’image d’une naissance à une vie éternellement heureuse.
Ceci est vrai, mais ne clôt nullement la rivalité entre science et religion. Tout d’abord parce que, renvoyée aux seuls terrains du malheur et de la mort, la religion n’est pas satisfaisante. Devrait-elle abandonner les gens heureux, ou n’avoir pour rôle que de leur rappeler que viendront aussi les jours d’échec et de mort ? N’est-ce pas confiner la religion dans un rôle doloriste, voire parfois masochiste, somme toute assez peu attrayant ?
Ensuite, parce que, même sur ces terrains où elle se trouve moins assurée, la science conteste aussi la réponse religieuse et tente de lui opposer ses propres méthodes. Elle cherche, inlassablement, à réduire la part du malheur et de l’échec. Non seulement dans le domaine matériel, mais très clairement aussi dans le champ psychologique et sociologique. Même sans y réussir, la science revendique une maîtrise sur tous les malheurs, qu’ils soient objectifs ou subjectifs. Et si elle connaît encore peu de succès dans ces derniers, elle y marque assez de points pour se sentir en marche vers un avenir meilleur. Elle s’attaque également à la mort, qu’elle espère éliminer un jour, ou tout le moins résoudre dans sa dimension de terme inacceptable.
Ceci peut sembler abusif. Les recherches psychologiques des cinquante dernières années en témoignent cependant à suffisance. Les études sur le vieillissement et la mort tout autant. On voit les scientifiques se passionner aussi pour la constitution des mythes individuels et sociaux et leurs pouvoirs sur le bien-être humain. On les voit même réinventer, comme la gnose de Princeton, un dieu et une religion à structure scientifique.
Naïvetés ? Sans doute, mais naïvetés très parlantes, puisqu’elles nous disent bien que la méthode et la démarche scientifiques revendiquent une puissance totale sur le bien-être humain et que, dans sa structure interne, la science ne trouve pas de motifs sérieux de s’arrêter en chemin. Bien au contraire, dans son histoire elle peut puiser tous les motifs de persévérer.
Résumons-nous. Dans la mesure où nous demandons du bien-être entre naissance et mort, la science supplante et supplantera plus encore la religion quant à l’efficacité de ses réponses. On peut rétorquer que ceci n’oblige pas d’opposer les deux réponses, soit qu’on prenne la réponse religieuse là où s’arrête la science, soit encore qu’on les fasse coexister dans le décours journalier de l’existence. Théoriquement, la chose est possible.
En fait, ce n’est pas si simple. La maîtrise du bien-être par la science fait appel à une attitude de confiance en l’homme, en son intelligence, son efficacité, sa capacité à maîtriser par ses propres forces son propre destin. L’attitude religieuse renvoie à la maîtrise de Dieu, au risque renouvelé d’ôter à l’homme toute confiance en lui-même. À tout le moins restera difficile le départage quotidien des décisions concrètes, de ce qui revient à Dieu et de ce qui revient à soi.
Une civilisation qui maîtrise la science semble bien déserter, de fait, ses propres églises. On retrouve surtout dans celles-ci les vieux, les mamies, les malades, pas même toujours les paumés de la vie !
Quant au bien-être que nous espérons, on peut donc dire que la science et la religion sont bien plus concurrentielles, voire antinomiques, que compatibles.
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Qu’on nous permette de déplacer légèrement le sens de cette citation de l’Évangile (Matthieu, 4, 4) : l’homme a besoin de paroles pour vivre, et même de paroles fondatrices. C’est-à-dire de mythes fondateurs qui lui assurent la création d’un monde cohérent, entre naissance et mort ; une vision du monde dans laquelle il puisse se situer, et situer la matière et les autres : construire l’histoire de ses désirs et de sa vie. Tant pour agir, au plan éthique, que pour se parler à lui-même, l’homme a besoin d’une création de sens. Ce sens répond aux questions inlassables et inévitables : qui suis-je ? D’où viens-je ? Où vais-je ? D’une certaine façon, la réponse ne peut être qu’unitaire et non morcelée, au moins dans sa visée ultime. Ce discours unitaire et fondateur du monde de la religion semble s’opposer très radicalement à la science.
Pour la science en effet, nous sommes de la même nature que le monde ; celle-ci est faite de particules liées par des énergies ; la vie sort des molécules organiques et notre esprit de l’organisation cérébrale. Pour la science, la combinatoire logique de notre esprit, ou Raison, est le stade dernier et actuellement suprême de ce monde. Cette Raison est en voie de se donner la maîtrise sur le monde, de par une sorte de retournement de la nature sur elle-même. Par postulat, la science élimine de tous ses raisonnements le recours aux esprits intentionnels supranaturels. Elle se contente de l’esprit humain ou Raison pour tenter toute explication, y compris de ses propres fondements. Elle pose le mythe de la capacité de l’homme dans cette démarche et ne met intrinsèquement aucune limite à ce mythe. Elle se donne comme pouvant offrir un jour, virtuellement, la maîtrise entière du bonheur humain par les seules forces naturelles et humaines.
C’est bien là, nous semble-t-il, la visée du marxisme « scientifique », celle de Poincaré et de Monod, celle de tant d’autres.
La religion fait appel à Dieu. La puissance de l’homme ne vient pas de la nature, mais seulement de Dieu, comme créateur premier et permanent. La science ne fait jamais, à ses yeux, que démontrer quelques mécanismes locaux sans pouvoir atteindre aucunement aux raisons premières, seules réellement fondatrices de l’homme et tout spécialement de son esprit. Ces raisons premières sont hors de nous, en Dieu. La science, puisqu’elle postule de ne rien dire au-delà de l’intelligence humaine naturelle, ne peut jamais affirmer ou infirmer Dieu. Ce dernier ne s’appréhende que dans une démarche de foi, dont Il est source et terme. À Son initiative, à la fois totale et première, Il invite l’homme, le rencontre et le transforme, même si quelque part Il nous laisse libre de répondre à cette invitation.
Quant à la raison fondatrice de l’humanité, la religion est donc radicalement hétérogène à la science. Bardée de concepts de métaphysique, de transcendance et surtout de foi, elle peut accorder à la science quelques exploits, puisque Dieu a donné à l’homme le monde à gérer. Mais elle garde pour elle le premier et le dernier mot, la science et toute sa gloire maîtrisante n’étant jamais que des illusions mondaines par rapport à la puissance première de Dieu.
Ne nous attardons pas. Pour autant qu’aucune des deux ne renonce à poser un mythe fondateur du monde, science et religion sont incompatibles, leurs mythes sont antinomiques, et nous n’avons pas la place pour deux discours des origines. Sur le terrain, dès lors, chacune tente d’asservir l’autre : la religion construit une philosophie et surtout une théologie des sciences. La science lui répond par une science des religions qui ramènerait celles-ci aux dimensions humaines. Que ces joutes se passent entre gens de bonne compagnie, policés parce que généralement académiques, n’y change rien. Tant qu’à nous trouver dans ces régions plus abstraites nous voudrions poser ici un jalon qui prépare nos positions futures.
Une question centrale est celle de la valeur, réaliste ou symbolique, des concepts dont nous nous servons. Ce problème nous semble traverser toute la polémique ci-dessus rappelée, tant du côté de la science que de celui de la religion. En d’autres mots : quelle capacité avons-nous d’accéder au réel, d’en dire la vérité par les mots et les concepts qui sont les nôtres ?
Deux positions nous semblent ici défendues. Pour les uns, en science comme en religion, notre parole semble capable d’accéder à la vérité du réel, d’y correspondre à peu près exactement, soit par la garantie de la foi, soit par la garantie des règles scientifiques.
Dire que Dieu existe, qu’il a créé le monde, s’est incarné, est ressuscité, renvoie à une sorte de correspondance réaliste et concrète de ces affirmations. De même que les lois scientifiques, au fil de leurs vérifications expérimentales et de l’affinement de leurs expressions mathématiques, renvoient à un modèle réaliste du monde. Les choses sont comme elles sont dites.
Pour les autres, dont nous sommes, ce réalisme est une illusion. Quel que soit son objet, la correspondance réaliste du discours humain avec ce qu’il désigne nous apparaît comme insoutenable. Bien plutôt, nous entrevoyons entre la parole et le réel un lien d’ordre symbolique, ou mythique. Dans cette optique, le réel, Dieu ou la nature peu importe, est toujours comme hétérogène à nos discours, désigné par eux mais les débordant et les infirmant toujours, tôt ou tard. Symboliques ou mythiques, nos discours ne sont cependant pas purement imaginaires : ils cernent quelque chose du réel, et exercent même un pouvoir modificateur sur celui-ci.
Ceci revient à affirmer qu’entre la structure symbolique de nos discours et le réel qu’ils tentent de désigner et de maîtriser s’inscrirait à tout jamais l’espace d’une différence qui rendrait tout réalisme précis et toute maîtrise exacte impossibles. Non sans que, par quelque mystère, une certaine correspondance permette l’influence de chaque terme par l’autre. Le réel, de la sorte, animerait notre discours tout en l’infirmant, le forçant sans cesse à changer. Tandis que nos paroles, en retour, ne seraient pas sans efficacité sur le réel, bien que cette efficacité reste de quelque manière non maîtrisable et visible seulement a posteriori.
Quelle rencontre !
En ramenant notre vision de la foi à une démarche amoureuse d’humanité et une éthique, nous interrogeons notre science. Est-ce tellement scandaleux ?
Nous avons indiqué plus haut qu’on peut y trouver une raison d’opter pour un statut symbolique du langage et cesser de croire à un discours scientifique qui serait posé comme la reproduction réaliste, terme à terme du réel. On peut y entrevoir que la démarche scientifique transforme le monde, le réel, peut-être beaucoup plus profondément que nous le soupçonnons, et puiser dans la vision de cette activité créatrice le sens d’une plus radicale responsabilité des scientifiques quant à notre devenir.
On peut aussi percevoir qu’une éthique « amoureuse » s’accommode assez mal de logiques causalistes et déterministes strictes tout entières imprégnées d’une idée de maîtrise radicale. On peut ramener cette logique au statut d’opérations efficaces mais très localisées, sans lui accorder un crédit universel sur la vérité du monde. On peut même – oserons-nous l’avouer ? – y trouver des raisons de préférer les théories de Bohr et Planck à celles d’Einstein, les théorisations de Prigogyne à celles des héritiers de Descartes et Newton, celles d’Atlan, en génétique, à celles de Monod ; celles enfin de psychologies constructivistes ou psychanalytiques à celles des psychologies étroitement organicistes ou behavioristes.
C’est-à-dire, au risque de paraître un peu étrange ou ridicule, préférer au nom d’une éthique « amoureuse » les théories scientifiques ouvertes qui acceptent le langage comme construction symbolique et mythique d’un réel non directement maîtrisable, et par là-même un espace d’incertitude créatrice.
AMEN ! Qu’il en soit ainsi !