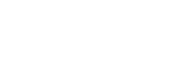Dans cette période plus que troublée, avec un futur plus qu’inquiétant, ne disposant pas de guides ou de grands hommes, il me reste à mettre en lumière le docteur Albert Schweitzer dont j’ai été le dernier assistant en 1964.
Il a été nommé le plus grand homme du siècle, auquel on peut adjoindre Mère Teresa et Che Guevara.
A la rencontre d’Albert Schweitzer
C’est là, à Lambaréné au Gabon, au cœur de la forêt vierge, que j’irai à la rencontre du célèbre médecin. J’ai vu trois fois le film qui lui a été consacré : Il est minuit, docteur Schweitzer. J’irai lui dire le rôle important qu’il tient dans ma vocation. Pour rejoindre Lambaréné et celui qu’Einstein tenait pour « le plus grand homme de notre triste monde », il faut survoler le continent africain. Le prix du billet d’avion pour cette destination est incompatible avec mes moyens. Où trouver l’argent ? La providence se manifeste. La forte motivation qui m’anime y est-elle pour quelque chose ? Une bourse m’est octroyée pour exercer à plein temps les fonctions de médecin résident à l’hôpital de Libreville durant les vacances universitaires. Pour compléter son équipe médicale, le directeur de l’hôpital m’affecte au service d’urologie. Le travail consiste essentiellement à déboucher, à coups de béniqué, des urètres obstrués par les nombreuses gonorrhées des patients admis dans le service. La fonction qui semble ingrate n’en est pas moins absorbante. Cela permet au jeune médecin que je suis d’acquérir de bons réflexes cliniques et thérapeutiques. Même si l’hôpital de Libreville, est l’endroit rêvé pour un carabin qui veut se confronter à son acquis pratique, à sa foison de connaissances livresques, ce n’est pour moi, en somme, qu’une étape sur la route de Lambaréné, c’est la perspective du privilège de partager, peut- être, la vie d’Albert Schweitzer, l’homme au-delà de la renommée internationale.
Vue d’avion, la forêt recouvre le centre du pays d’un épais manteau vert profond, marbré de tâches jaunes, là où se situent les rares clairières. Les reflets répétés de l’eau constellent l’immensité tropicale de maints scintillements. Cette forêt obscure et mystérieuse dissimule un monde végétal et animal grouillant de vie. Le Gabon est vaste comme la moitié de la France, ni routes ni voies ferrées, seules quelques pistes rouges de latérite se faufilent à travers la marée forestière. Des petits îlots, constitués de paillotes égarées, parsèment cet espace infini. Une fois le plancher des vaches retrouvé, à bord d’une Land Rover brinquebalante qui sillonne la piste, fourbu et tout collant de sueur poussiéreuse, je suis en route pour Lambaréné, chef-lieu de district. M’y voici enfin ! Je suis à l’approche de Lambaréné.
Le lieu est une escale fluviale qui étale tout au long de ses berges ses factories, ses magasins-entrepôts et ses commerces en tous genres. Les débarcadères animés, odorants, colorés, donnent à l’endroit une allure portuaire. La colline proche abrite sur ses pentes les cases des fonctionnaires hiérarchiquement étagées. Celle qui culmine est réservée au préfet. L’agglomération dissimulée derrière le coteau s’éparpille en bordure de piste dans la brousse, au-delà des comptoirs. Sans m’attarder, j’embarque sur une frêle pirogue, unique moyen de transport me permettant d’atteindre ma destination finale. Ces embarcations très plates et très étroites sont taillées dans un seul tronc et chavirent au moindre mouvement. J’ai le sentiment qu’au plus petit éternuement nous risquons d’être avalés par les flots bourbeux. Les pagayeurs se tiennent debout, rendant l’embarcation encore plus instable. Avec leurs longues pagaies, ils frappent l’eau en chantant pour garder la mesure. Je finis par surmonter mes craintes et jouis enfin de cette traversée inoubliable. Après une heure de navigation, le royaume du docteur Schweitzer commence. Assis dans le fond de la pirogue, j’aperçois un minuscule débarcadère encombré de hors-bord et de pirogues identiques à la mienne. Une horde d’enfants patauge, s’éclabousse, tandis que des femmes lavent leur linge dans les eaux saumâtres charriant les détritus de la forêt équatoriale.
Une infirmière blanche est venue m’accueillir. A sa suite, j’escalade les marches qui conduisent au village- hôpital du docteur. Quel contraste ! Après l’éblouissante lumière et le silence concentré du lit du fleuve que je viens de parcourir, je suis saisi par un grouillement diffus, qui se cache dans la voûte inextricable de la végétation alentour. Dans ce fouillis informe, des senteurs de bois brûlé, de manioc bouilli, se mêlent aux effluves plus familiers du tabac et des médicaments. Mes yeux s’accoutument à la pénombre enfumée, zébrée de rais lumineux s’immisçant dans les grandes futaies d’acajous et de fromagers. Je distingue enfin quelques personnes affairées entre les pilotis de quelques cases éparses.
Je vois avec beaucoup d’émotion ce beau vieillard à peine voûté malgré ses quatre-vingt-dix ans avancer dans ma direction. Dans sa tenue blanche, casque colonial à la main, Albert Schweitzer en personne vient m’accueillir. Sa moustache et sa chevelure argentées rappellent celles de Nietzsche ou d’Einstein. Ses yeux, à demi masqués par des sourcils en broussaille, irradient d’un éclat chaleureux et magnétique. Immédiatement, je sens peser sur moi son regard pénétrant. Il me dévisage. Je suis certain qu’il est en train de lire dans mes pensées. Je serre, timoré, la lourde main calleuse tendue. Cette main me fait penser à celle d’un paysan de mes Ardennes natales. Il m’adresse la parole d’une voix grave et timbrée émaillée de chuintements appuyés dus à son fort accent alsacien.
« “Ponchour”, mon “cheune” ami ! Comment “allez- fous” ? »
Les premières banalités de circonstance sont échangées. Il s’enquiert de mes intentions, s’informe sur ma formation et mon parcours. En apprenant mes origines ardennaises, il décide de m’appeler le « Viking ». Je n’aurai pas de mal à assumer ce sobriquet puisque c’est celui dont je suis déjà affublé en faculté. Brusquement, il éclate d’un grand rire contagieux. Aussi soudainement, il me demande de l’aider dans son œuvre, moi qui suis simplement venu en visite. Je n’en espérais pas tant ! Lui avoir serré les mains aurait suffi à mon bonheur. Le courant passe, ma timidité s’évapore, je suis conquis. Il me convie à sa table. Comme les agapes des premiers chrétiens, les repas sont pris en commun deux fois par jour dans la salle à manger. J’apprendrai bientôt que la ponctualité est une des caractéristiques du lieu. Aucun hôte convié à la « cérémonie » n’a pu l’oublier. Autour d’une longue table, patientent ses vingt collaborateurs. La solennité et la simplicité du repas évoquent la Cène. Le médecin missionnaire entre, et tous se lèvent. Il s’assied, tourne la tête à droite, à gauche, avant de prononcer le bénédicité, en français ou en allemand, selon la représentativité. Cela rituel exécuté, il me présente :
«J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau collègue ! »
Cette introduction résonne dans mon esprit comme une intronisation. Pour les « apôtres » debout devant la table dressée, cela signifie simplement qu’un médecin de plus s’est joint à eux pour soulager une parcelle de la misère du monde. En fin de repas, il prononce, comme chaque fois, un très court sermon et se lève pesamment, m’invitant à effectuer un tour du propriétaire avec lui.
Ici, chacun, qu’il soit simple étudiant ou riche rentier, porte la tenue réglementaire : chaussettes ou bas blancs, chemise blanche et casque colonial. Je dois me conformer à la règle. Comme je ne dispose d’aucun des éléments évoqués, j’ai le privilège de me voir remettre de ses mains son casque de réserve, ses chaussettes et une de ses chemises sur laquelle est imprimé son nom. J’apprécie cette panoplie qui revêt un caractère hautement symbolique. Me précédant sur le chemin qui conduit à de longues cabanes sur pilotis aux toits de tôle et aux murs à claire- voie, il commente le tour en propriétaire.
Le radeau humanitaire
J’ai le sentiment de m’être aventuré loin de toute civilisation dans un kaléidoscope géant où les repères habituels sont subordonnés à la nature toute-puissante. Même les poteaux semblent prendre racine en enchevêtrements luxuriants. Nous descendons entre deux pavillons étalés en longueur. Tout un monde s’affaire comme dans un souk. Hommes, femmes, enfants, flânent sur le lieu côtoyant chevrettes trapues, poulets au cou déplumé, porcelets noirs, ronds et poilus qui fouillent de leur groin dans les immondices. Dans l’air enfumé, bleuté, une ronde d’insectes frénétiques scintille par intermittence. Je suis touché par la simplicité rustique de l’ensemble où rayonne une chaleur humaine significative. Le village-hôpital, enfoui sous les grands arbres, est plongé dans une semi-pénombre permanente qui entretient l’humidité et la moisissure. Sous l’Equateur, en saison des pluies, le ciel est souvent gris et bas. Il plane au-dessus du site un épais nuage de fumée montant des cuisines africaines.
Ici, les malades sont comme dans leur propre village, ils vivent avec leurs parents proches ou éloignés : femme, enfants, père, mère, oncles, tantes. Ils ont même apporté leurs animaux, leur cuvette et leur cafetière. Ils préparent leur tambouille de poissons séchés relevés de pili-pili, un piment rouge très fort, et fument tranquillement en participant à la palabre. Les eaux de pluie, les eaux de lavage, les déchets de cuisine et toutes les immondices que produisent gens et animaux s’écoulent entre les bâtiments dans des fossés de drainage. Par respect pour l’environnement (une préoccupation rare à l’époque), tous les baraquements sont en bois. Tout est chevillé, pas de clous. Il n’est pas question de traiter à la créosote les parties enterrées. Les termites s’en donneraient à cœur joie. Par terre ou sur les toits en tôle rouillée, sèchent en permanence le linge des malades, les pagnes, les bandages et les pansements lavés par les membres de la famille.
Souvent, les visiteurs sont effarés par le village-hôpital qu’ils voient vétuste et sale. Schweitzer a souvent dit qu’il n’avait pas voulu faire un hôpital-clinique, mais un village-hôpital africain où le malade se sent chez lui, où il se retrouve avec sa famille, ses habitudes, conditions indispensables pour sa guérison.
Ce village pourrait-être un exemple d’écologie assez réussi, puisque la plus grande partie des déchets disparaissent dans l’estomac des cabris promeneurs, à commencer par les monceaux de peaux de banane jetées devant les cases.
On a souvent reproché au docteur Schweitzer de refuser la modernisation. Il a maintes fois prouvé qu’il n’est pas contre la modernisation, mais il a une idée précise de la modernisation qui convient, en forêt équatoriale, à des populations peu évoluées.
Les Blancs ne disposent que d’une seule latrine fermée à clé et réduite à une simple planche trouée posée au- dessus d’une fosse grouillante d’asticots qui se déversent avec la nuée de mouches dans le jardin potager. L’eau est puisée dans l’Ogooué. Le puits est équipé d’une pompe à main ; les malades et le personnel viennent puiser une eau polluée, limoneuse, qui sert aussi bien à la lessive qu’à la douche. Quant à l’électricité, malgré la présence d’un générateur capable d’éclairer tout le village, elle est réservée à la salle d’opération, au laboratoire et à la salle de radio. Ce grand village ne ressemble à aucun autre. Il est disparate, composé de personnel blanc et noir, de familles, de malades, d’accompagnateurs, de visiteurs, de près de deux cent cinquante moutons et cabris, de centaines de chiens, d’antilopes et de singes, de nombreuses volailles, de jardins et de potagers, de campements annexes. Cette communauté que Schweitzer fait vivre dans le respect de l’environnement culturel du malade est à l’avant-garde d’une prise de conscience de l’aspect psychoaffectif de la société humaine. Cette osmose de tous les éléments a de quoi faire frémir l’épidémiologiste, mais la priorité va au confort moral de l’Africain qui ne se sent pas dépaysé.
Les bâtiments de la partie basse en bord de fleuve sont construits sur pilotis pour parer aux inondations, mais également pour se protéger de la vermine et des serpents. Albert Schweitzer a imaginé une façon logique et astucieuse de construire tous les bâtiments selon l’axe est-ouest afin que le soleil apporte ses bienfaits aux faîtières et aux parties supérieures des constructions. Les parois externes sont grillagées de manière à laisser s’évacuer la chaleur qui monte. Sur les toits, la tôle ondulée a remplacé la paille pour éviter d’avoir à la renouveler. Les autres bâtiments, en retrait, au milieu des arbres, sont disposés en fonction des besoins de chacun et de l’espace dévolu.
Le contrebas de l’hôpital, un peu à l’écart de la montée des eaux, est réservé aux Africains malades et aux accompagnateurs. C’est une véritable cour des miracles. Dans l’espace restreint de hangars ouverts à tous vents, les malades couchés sur des bat-flancs en planches superposées s’entassent. Ils ont pour matelas de l’herbe ou de la paille recouverte d’un simple pagne. On entre pose dessous le bois, les ustensiles de cuisine, le manioc et les bananes.
La consultation
La consultation des malades « extérieurs » est toujours à 10 heures car le début de la matinée est consacré aux malades hospitalisés. La plupart des patients viennent des villages voisins et même de régions très lointaines. Ils arrivent à pied, en camion, en pirogue. Ils sont originaires de Libreville, de Port-Gentil, d’Oyem, de Ndende, de Franceville, de Ychibanga. On apprend que tel malade a fait trois semaines de pirogue pour arriver à l’hôpital. Quelques Blancs prennent l’avion ; les petits avions particuliers commencent à être très utilisés sur les chantiers.
L’organisation de l’hôpital n’a guère changé depuis cinquante ans. Les malades se regroupent toujours selon leur ethnie pour faciliter la tâche des infirmiers-interprètes capables de traduire cinq ou six langues vernaculaires. À chaque patient est remis un ticket : un disque en carton traversé par une ficelle en raphia pour le porter autour du cou. Sur ce disque est inscrit un numéro auquel correspond, sur le registre de l’infirmier, son nom, son prénom, sa maladie et les remèdes qu’il a reçus. Si le patient revient, même longtemps après, on peut rapidement l’identifier et suivre l’évolution de sa maladie.
Quand les interprètes ont ramassé tous les tickets et ont sorti des fichiers les cartes correspondantes, la consultation peut commencer. L’entrée en matière est presque toujours la même :
« Alors ! Qu’est-ce que tu as ?
Docteur, le ver me pique là-dedans.
Comment ça a commencé ?
Il s’est mis dans la jambe, puis il est monté dans la tête. Puis il a rongé le cœur. Et maintenant il est dans le ventre, là.
Est-ce que tu tousses ? »
La réponse est longue et confuse : le malade raconte force détails, souvent pendant plusieurs minutes. Finalement l’interprète traduit : « Oui, il tousse. »
Alors, on passe à l’auscultation. Le malade s’allonge sur une table, derrière des rideaux blancs. Le médecin l’examine, puis lui rédige une fiche pour aller au labo afin de se soumettre à une prise de sang, un examen d’urine ou de selles. Quand il revient avec les résultats, un diagnostic est établi et un traitement ordonné. Le malade va alors se placer dans la file d’attente, devant le comptoir de la pharmacie, et reçoit ses médicaments. L’interprète insiste lourdement sur la posologie :
« Tu prends un comprimé ! Pas deux ! Un seul ! Tu le prends quand le soleil se lève. Un autre comprimé quand le soleil est là-haut, tout droit ; et un autre comprimé quand le soleil se couche. Tu as compris ? Trois comprimés, tous les jours. Pas toute la boîte ! Maintenant… cette poudre… une pincée, comme ça, tous les matins, dans un verre d’eau. De l’eau jusque-là ! D’accord ? Bon. Cette pommade, pour frictionner ton bras, tous les matins. Pour frictionner seulement ; pas manger ! Poison ! D’accord ? Alors, je répète : les comprimés, trois par jour ; la poudre tous les matins dans un verre d’eau ; et la pommade, tous les matins sur le bras. Voilà ! Et tu dois revenir nous voir dans quinze jours. Quinze ! Je t’attends. Au revoir. »
Et le patient s’en va, rassuré. Il guérira, c’est sûr, puisqu’il a été soigné chez le Grand Docteur.
La Cour des Miracles
Le docteur Schweitzer marche lourdement devant moi en se frayant un chemin parmi les malades : je découvre des enfants aux grands yeux curieux et aux petits ventres nus tout bombés, des bébés barbouillés et morveux, instables sur leurs jambes fluettes, des éclopés de tous âges, des vieillards grisonnants ; l’un d’eux se promène avec son sac herniaire entre les jambes (les intestins sont passés dans les testicules)… Le docteur s’arrête quelquefois pour caresser la tête crépue d’un bambin. Une longue file d’attente se presse sur les marches d’une baraque. Les malades qui viennent à la consultation en ressortent des médicaments au creux de la main. Face à ce pavillon des entrées et des consultations externes, se trouve celui des hospitalisations. Dans ce dernier sont logés les opérés et les malades graves. Par de hautes ouvertures, on entrevoit des lits de bois étroits et superposés, tous occupés par des patients cachés sous d’épais rideaux gris faisant office de moustiquaire. Entre les lits, des femmes accroupies entretiennent la flamme sous des cafetières au cul noir, tandis que d’autres circulent non chalamment en mâchant de l’iboga ou en tirant des bouffées sur leur petite pipe en terre. Une vieille femme essaie d’extraire avec une lame de couteau les puces-chiques logées sous les ongles de pied de son petit-fils. Il y a des hernieux, des opérés de l’abdomen aux bandages propres, des plâtrés, des fiévreux au teint gris suant dans la pénombre chaude. Couchés sur de simples nattes, ils ont tendance à repousser leur couverture au pied de leur lit de planches. Le docteur commente au passage : « Hernie incarcérée, résection intestinale, appendicite… » Des traumatisés couchés pour une fracture de la jambe ont été mis en extension. Des bobines font office de poulies. A Lambaréné, il faut être technicien de l’improvisation !
Sur un grabat, une malade cachectique aux yeux d’or nous observe. Le vieux docteur commente : « Bilieuse… Malaria… »
Un agité trempé de sueur déambule près de nous dans l’allée. Toutes les souffrances sont entassées dans cette cage à claire-voie. L’air moite accentue les odeurs balsamiques des corps qui macèrent. Ces effluves ne m’inspirent ni dégoût ni pitié, tant se devine par ailleurs le dévouement désintéressé du personnel soignant. Au bout d’une allée grillagée, je découvre la salle d’opération. Elle est agencée d’une simple table d’examen recouverte de toile écrue et d’un petit projecteur électrique, unique concession de Schweitzer à la civilisation. Un cagibi ouvert sur l’extérieur par des panneaux de moustiquaire tombant du plafond jusqu’au plancher est adjacent au lieu. Ici, une légère odeur de grésil et de chloroforme flotte.
Après un petit déjeuner composé de soupe et de café, le patriarche répartit les tâches de la journée aux employés africains, proches parents des malades, qui viennent, faute d’argent, offrir leurs services en échange des soins apportés à leur malade. L’agitation ambiante autour de Schweitzer lui est manifestement nécessaire. Il l’appelle : sa « confusion organisée ». Cette cacophonie agencée semble l’aider à s’immerger dans l’atmosphère de son hôpital. Le docteur ne consulte plus depuis longtemps, mais tient à être informé quotidiennement du moindre détail. Je suis surpris de découvrir qu’il recrute ses jeunes collaborateurs médecins, frais émoulus des universités, sans se soucier outre mesure que ceux-ci manquent de pratique en chirurgie et d’expérience en médecine tropicale. Le maître des lieux compte davantage sur l’enthousiasme et la motivation. Ces volontaires sont les précurseurs des french doctors. En vivant cette belle aventure, ils désirent tous donner un sens à leur vie. Certains connaîtront de grandes désillusions. La vie communautaire, les conditions sanitaires précaires, les sollicitations incessantes auront raison de leur bel enthousiasme du départ.
Par un couloir obscur, nous arrivons à la pharmacie où sont entreposés bocaux étiquetés, comprimés, poudres et ampoules. Je ne remarque aucune de ces boîtes publicitaires qui ornent les rayons de nos stocks de médicaments occidentaux. Ici, le malade tend sa bouche ouverte et l’infirmière administre le « médicament » comme la mésange distribue sa pitance à son oisillon. Ainsi est-on certain que les doses prescrites seront effectivement prises.
L’autre partie de l’hôpital, réservée aux Occidentaux, est située un peu plus haut sur la colline. Autour de sa grande cour centrale, les blanchisseuses, les repasseuses et le tailleur évoluent. Six baraques sur pilotis, aux toits de tôle, sont attribuées aux visiteurs et au personnel européen. C’est le seul hôtel de la région. De grandes vérandas couvertes d’auvents protègent du soleil et des pluies tropicales. Infirmières et médecins logent là, dans de simples box spartiates de cinq mètres carrés meublés d’une table, d’un lit, d’une lampe à pétrole, d’une cuvette émaillée et d’un broc pour la toilette. Ces « chambres » sont séparées par des cloisons qui ne montent pas jusqu’au plafond, histoire de délimiter un semblant d’intimité. Les ébats amoureux ne peuvent se passer qu’à l’extérieur, le soir après le travail, sur un banc de sable ou au pied d’un énorme fromager. Schweitzer, très exigeant sur la moralité de sa communauté, a imposé cette discipline. La beauté des femmes de certaines ethnies locales peut faire tourner la tête. Ces femmes traînent leur gracieuse langueur parmi les bassines et les tas de manioc. Elles s’habillent de peu de chose, souvent d’un simple pagne ceint autour de la taille, ou d’un caraco. La culotte restant un accessoire surfait.
À l’écart, surplombant les toits des baraquements enchevêtrés, un bâtiment tout en longueur lui aussi, avec un balcon conçu comme un phalanstère, sert de logis au maître des lieux. C’est la seule vraie paillote de Lambaréné. En face se trouve le réfectoire, le cœur de Lambaréné. Ces deux bâtiments délimitent un espace protégé où il est interdit de photographier.
La table de travail de Schweitzer n’est séparée du laboratoire que par un grillage. Penché sur ses papiers, le porte-plume entre l’index et le médius, il écrit ses lettres, il passe ses commandes, il répond aux grands de ce monde, aux demandes de séjour des médecins et des infirmières. La paperasse s’entasse autour de lui. Mathilde ou Ali mettront de l’ordre. L’essentiel est de préserver, sur la table, la place de Carmen, la chatte, et de son fils Barnabas, ainsi que le « garde-à-manger » des fourmis. Elles arrivent en colonne, montent le long du pied de la table, et viennent manger, à l’angle du bureau, les miettes et l’eau sucrée préparées par le docteur. Pour les protéger des chats, il a posé, à l’envers, un de ces petits paniers grillagés qui servent à stériliser les objets en verre. Sous cette cage protectrice, les fourmis organisent leur travail, sous le regard insidieux de Carmen qui, de temps en temps, cherche à soulever la petite cage avec sa patte.
« Arrête, Carmen ! Je ne veux pas que tu manges les fourmis ! Elles ne t’ont rien fait ! Tu as eu ton repas, toi ! Alors, dors ! »
A l’extérieur, se livrant à son travail permanent de voirie, la troupe disparate des poules, des chèvres, des moutons, des chiens, des antilopes, des chimpanzés, d’un gorille manchot et d’un pélican perché sur l’angle du toit, immobile comme une gargouille.
La vie de l’hôpital est réduite aux choses essentielles : le travail, l’amour d’autrui, et la nature qui dresse son décor sublime. Le soir, au réfectoire, tous les médecins se retrouvent et forment une véritable communauté autour du patriarche qui peut être, selon son humeur ou selon ses soucis, un simple témoin silencieux, presque absent, ou au contraire un animateur insoupçonné, un raconteur d’histoires, un organisateur de distractions.
Le repas est toujours précédé de la courte prière du docteur : « Bénissons l’Éternel, car il est bon et sa miséricorde dure éternellement. » Ces mots sont prononcés humblement, gravement.
Ce soir, le patron a envie de parler. Après le repas, on débarrasse la table, Schweitzer va au piano et improvise un prélude de Rachmaninov.
Le lendemain matin, une longue journée s’annonce. Il n’y a pas de place pour l’ennui. Le maitre des lieux me veut à ses côtés, je suis le seul médecin parmi les dix à parler de religion et de Dieu. Quand on réalise que la flamme de la petite bougie ne va pas tarder à s’éteindre, il faut se préparer ! C’est ainsi que je deviens son interlocuteur. Mais Albert a encore des forces !
Dans d’autres lettres, je prolongerai le dialogue.